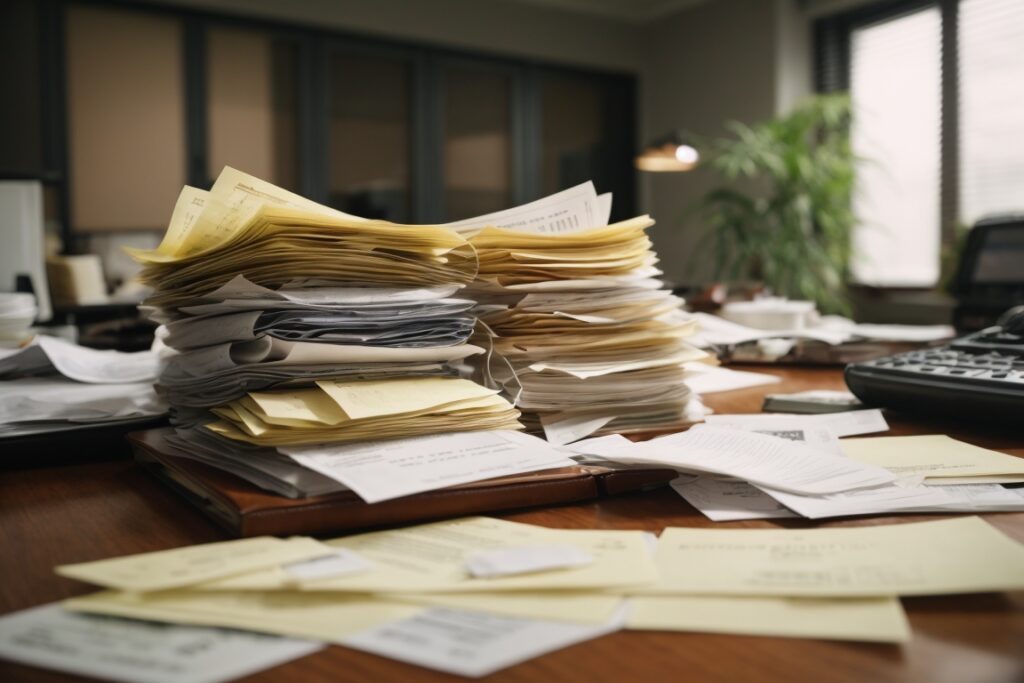Procédures de recouvrement judiciaire : Guide 2025

Pour une entreprise, les factures impayées représentent un risque financier majeur pouvant menacer sa trésorerie et sa pérennité.
Lorsque les tentatives de recouvrement amiable échouent, il devient indispensable de passer à l’étape suivante : le recouvrement judiciaire.
Cette démarche permet au chef d’entreprise de faire valoir ses droits et de récupérer les sommes dues par voie légale.
Le recouvrement judiciaire s’appuie sur des procédures spécifiques telles que l’ injonction de payer, le référé provision, ou encore l’ assignation au fond.
Ces solutions offrent aux entreprises des moyens concrets pour obtenir un titre exécutoire et contraindre le débiteur au règlement de ses dettes.
Dans cet article, nous vous présentons les différentes options qui s’offrent à votre entreprise, les conditions à remplir, les délais à respecter, les avantages et les inconvénients de chaque procédure judiciaire.
Sommaire
I – Tableau comparatif des 3 procédures de recouvrement judiciaire
| Injonction de payer | Référé-provision | Assignation au fond | |
|---|---|---|---|
| Type de procédure | Simplifiée | Urgence | Dossiers complexes & montants élevés |
| Durée de la procédure | 2 à 6 mois (délai d'opposition inclu) | 1 à 3 mois | 6 mois à 2 ans ou plus |
| Montant concerné | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite |
| Mise en demeure préalable | Obligatoire avec accusé de réception | Non obligatoire, mais fortement conseillée | Obligatoire |
| Conditions requises | Créance valide (certaine, liquide, exigible et non prescrite) | Créance valide (certaine, liquide, exigible et non prescrite); urgence et absence de contestation sérieuse | Créance valide (certaine, liquide, exigible et non prescrite) |
| Applicable si contestation du débiteur ? | Non : Si contestée, la procédure devient contradictoire et est renvoyée devant un juge | Possible, mais limitée : seules des contestations sérieuses peuvent bloquer la procédure | Oui : conçue pour traiter les litiges et les créances contestées, avec un débat contradictoire devant le juge |
| Quand l'utiliser ? | Créance non sérieusement contestable, issue d'un contrat ou d'instruments de paiement, comme une facture impayée | Procédure d’urgence pour obtenir un paiement rapide | Créance contestable ou montants importants ; souvent utilisée après échec des procédures accélérées |
| Qui peut engager la procédure ? | Avocat Créancier professionnel Créancier particulier | Avocat Créancier professionnel | Avocat Créancier professionnel Créancier particulier Société de recouvrement |
Notre cabinet d’Avocat possède un pôle recouvrement dédié aux entreprises pour recouvrir les créances B2B partout en France et à l’international.
Besoin d’un conseil, d’aide ou d’accompagnement dans le cadre d’un recouvrement amiable et/ou d’un recouvrement judiciaire ?
✅ Contactez un avocat spécialisé en recouvrement de créances avant qu’il ne soit trop tard.
II – Définition du recouvrement judiciaire
Le recouvrement judiciaire constitue le dernier recours pour une entreprise confrontée à des factures impayées, lorsqu’aucune solution amiable n’a abouti.
Cette procédure légale vise à contraindre le débiteur à régler sa dette en obtenant un titre exécutoire, délivré par un juge.
Ce titre permet au créancier de faire appliquer des mesures coercitives comme la saisie des comptes bancaires ou des biens du débiteur, conformément au code des procédures civiles d’exécution.
Parmi les principaux outils du recouvrement judiciaire figurent :
- L’injonction de payer, pour des créances non contestées et rapidement exécutables ;
- Le référé-provision, une solution d’urgence permettant d’obtenir une avance sur une créance non sérieusement contestable ;
- L’assignation au fond, adaptée aux litiges complexes ou aux montants importants.
Ces démarches, bien que contraignantes, nécessitent une préparation rigoureuse.
La créance doit être certaine, liquide et exigible, et l’entreprise doit s’assurer de respecter les délais de prescription, généralement fixés à 10 ans pour un titre exécutoire.
En cas d’exécution forcée, des procédures civiles supplémentaires peuvent être nécessaires si le débiteur persiste dans son refus de payer.
III – Quelle est la différence entre le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire ?
Le recouvrement de créances se décline en deux grandes catégories : le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire.
1. Le Recouvrement Amiable
Cette première étape consiste à entrer directement en contact avec le débiteur pour trouver une solution au règlement d’une facture impayée.
Dans de nombreux cas, une simple relance par téléphone, e-mail ou courrier suffit à obtenir le paiement.
Si la situation est plus complexe, le créancier peut proposer des délais de paiement ou un échéancier adapté.
En l’absence de réponse favorable, une mise en demeure peut être adressée au débiteur.
Ce courrier recommandé avec accusé de réception marque l’ultime étape du recouvrement amiable.
À partir de son envoi, des pénalités et intérêts de retard peuvent être appliqués, conformément aux termes du contrat ou à la législation en vigueur.
💡 Bon à savoir :
Bien que le créancier ne soit pas légalement tenu d’effectuer des relances avant d’envoyer une mise en demeure, cette démarche est vivement conseillée.
Elle témoigne d’une recherche active de solution, ce qui est apprécié par les juges en cas de contentieux.
2. Le Recouvrement Judiciaire
Si le recouvrement amiable échoue malgré l’envoi d’une mise en demeure, la procédure judiciaire peut être engagée.
Cette étape consiste à saisir un juge compétent pour obtenir le paiement de la créance par voie légale.
Contrairement à la phase amiable, qui repose sur une incitation au règlement, le recouvrement judiciaire a pour objectif de contraindre le débiteur à payer.
✔️ À retenir :
La mise en demeure est une condition préalable obligatoire pour initier une action en justice.
Préparer et formaliser cette étape correctement est donc essentiel pour assurer le succès d’une procédure judiciaire.
IV – Dans quels cas peut-on avoir recours à un recouvrement judiciaire ?
Si le recouvrement amiable n’abouti pas, les principaux cas de figure où la procédure de recouvrement judiciaire peut être engagée sont les suivants :
- Non-respect des délais de paiement : Si le débiteur ne paie pas à l’échéance fixée sur la facture ou le contrat.
- Absence de tout paiement : Si malgré les relances, aucun versement n’a été effectué par le débiteur.
- Litiges commerciaux : Lorsqu’une créance est contestée dans le cadre d’un différend entre entreprises.
- Contrats de prestation de service non honorés : Si le débiteur refuse de payer une prestation réalisée conformément aux termes convenus.
- Impayés de montants élevés : Si les créances sont importantes et nécessitent des mesures coercitives spécifiques.
- Recours en urgence : Pour demander rapidement une provision via un référé-provision en cas de créance non sérieusement contestable.
V – Les conditions préalables pour engager un recouvrement judiciaire
Avant d’entamer un recouvrement judiciaire, certaines conditions préalables doivent être réunies. Ces exigences garantissent que la procédure est fondée et recevable devant les tribunaux.
1. Condition préalable : la mise en demeure
La première étape incontournable est l’envoi d’une mise en demeure de payer.
Cette démarche marque la transition entre le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire.
La mise en demeure est un courrier officiel, généralement envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans lequel le créancier exige formellement le paiement de la dette
Ce que la mise en demeure doit contenir :
- Une description claire et précise de la créance (montant dû, date d’échéance, références éventuelles).
- Une demande explicite de paiement sous un délai fixé (généralement 8 à 15 jours).
- L’indication des éventuelles pénalités de retard et frais de recouvrement applicables.
La mise en demeure est essentielle, car elle formalise la demande et permettra de prouver au juge que le débiteur a été prévenu avant l’engagement d’une procédure judiciaire.
📝 À noter :
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour toutes les procédures (par exemple, référé-provision), la mise en demeure est fortement recommandée, car elle peut être exigée par le juge pour démontrer que vous avez tenté une résolution amiable.
2. Conditions relatives à la créance
Pour que le recouvrement judiciaire soit recevable, la créance doit répondre à quatre critères fondamentaux :
- Certaine :
La créance doit exister juridiquement et ne pas être sujette à débat.
Elle doit être fondée sur un contrat, une facture ou tout autre document probant.
Une créance contestable pourrait nécessiter une assignation au fond, une procédure plus longue.
- Exigible :
La créance doit être immédiatement réclamable par le créancier.
Par exemple, si un délai de paiement est stipulé sur la facture, il faut attendre l’échéance avant d’engager une action judiciaire.
- Liquide :
La créance doit être chiffrée avec exactitude.
Un montant approximatif ou indéterminé ne sera pas recevable en justice.
- Non-prescrite :
Le délai légal pour agir en recouvrement ne doit pas être dépassé (voir ci-dessous 👇).
VI – Délai pour agir dans le cadre d’un recouvrement judiciaire
Lorsque vous engagez une procédure de recouvrement judiciaire, il faut respecter les délais de prescription pour garantir l’aboutissement de votre demande.
Au-delà de ces délais, la dette est prescrite ; même si votre créance est certaine et appuyée par des preuves solides, elle sera considérée comme irrecevable par les tribunaux.
1. Délais de Prescription : Quelles différences selon la nature du débiteur ?
Les délais de prescription varient selon la nature du débiteur :
- 2 ans (sous condition) : si votre débiteur est un particulier ;
- 5 ans : si votre débiteur est un professionnel.
Par exemple, le délai de prescription d’une facture impayée est calculé à partir de la date d’échéance de la facture, c’est-à-dire le jour où la créance devient exigible.
C’est pourquoi il est essentiel de surveiller attentivement cette échéance et d’agir rapidement en cas d’impayé.
VII – Pénalités et frais de recouvrement judiciaire
Le créancier peut réclamer des pénalités de retard et des frais de recouvrement dans le cadre des trois procédures de recouvrement judiciaire, à condition que ces demandes soient prévues contractuellement et légitimement justifiées.
Le juge peut moduler les demandes selon le principe de proportionnalité et en fonction de la situation du débiteur, notamment lorsque la créance est contestée, certains frais ou pénalités peuvent alors être rejetés ou revus à la baisse.
In fine, c’est le juge qui détermine si les frais engagés relèvent des « dépens » au sens de l’article 696 du Code de procédure civile et qui décide de leur répartition entre les parties, en les faisant supporter totalement ou partiellement par la partie perdante.
1. Pénalités de retard
Les pénalités de retard doivent être mentionnées dans le contrat ou sur la facture, conformément à l’article L441-10 du Code de commerce pour les transactions commerciales.
Les pénalités de retard commencent à courir dès l’expiration du délai de paiement mentionné sur la facture ou après l’envoi d’une mise en demeure, sauf mention contraire dans les conditions contractuelles.
Si aucune mention n’est prévue, le taux d’intérêt minimum peut s’appliquer.
En effet, le taux d’intérêt des pénalités de retard pour les créances professionnelles est de minimum 3 fois le taux d’intérêt légal.
2. Frais de recouvrement
Les frais de recouvrement doivent être justifiés (preuves à l’appui) et proportionnels à la créance.
Le créancier peut réclamer des frais liés à la procédure de recouvrement judiciaire, tels que :
- Une Indemnité forfaitaire de recouvrement : Un minimum de 40 € pour les créances professionnelles.
- Les honoraires d’avocat : Pour la rédaction d’une mise en demeure ou la représentation en justice.
- Les frais de justice : Par exemple, les coûts liés à l’intervention d’un commissaire de justice.
VIII – Les trois types de procédures judiciaires possibles
1. La procédure d’injonction de payer : Conditions, démarches et coûts
La procédure d’injonction de payer est une démarche rapide et simplifiée permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire pour le recouvrement d’une créance.
Cependant, la créance doit être incontestable, elle ne s’applique que dans certains cas spécifiques :
- Créance issue d’un contrat, comme une facture impayée ou un accord signé ;
- Créance fondée sur des instruments de paiement, tels qu’une lettre de change, un billet à ordre ou l’acceptation de la cession d’une créance professionnelle.
Ainsi, elle est particulièrement adaptée pour les professionnels souhaitant récupérer des créances commerciales avec un minimum de complexité.
La requête d’injonction de payer doit être déposée auprès du greffe du tribunal compétent :
- Le tribunal judiciaire si l’une des parties est un particulier ;
- Le tribunal de commerce si les deux parties sont des professionnels.
La procédure étant non contradictoire, le juge statue uniquement sur la base des éléments fournis par le créancier.
Deux cas de figure à l’issue du jugement :
- La requête est jugée fondée : Une ordonnance d’injonction de payer est délivrée, équivalente à un titre exécutoire. L’ordonnance doit être signifiée au débiteur par un commissaire de justice dans un délai de 6 mois. À défaut, l’ordonnance devient caduque.
- La requête en injonction de payer est rejetée : Le créancier n’a aucun recours et devra engager une assignation en paiement pour poursuivre.
📝 À noter :
Le débiteur dispose d’1 mois après la signification de l’ordonnance pour faire opposition à l’injonction de payer.
Si une opposition est déposée, les deux parties sont convoquées devant le tribunal pour un examen contradictoire, ce qui allonge la procédure.
Lorsque le montant dépasse 10 000 €, la représentation par un avocat est obligatoire.
Si le débiteur n’émet pas d’opposition dans le délai imparti, l’ordonnance devient exécutoire.
Dès lors, si le débiteur ne paie pas volontairement, le commissaire de justice peut alors procéder à des saisies (comptes bancaires, biens mobiliers, etc.).
2. Le référé-provision
Le référé-provision est une procédure d’urgence qui permet au créancier d’obtenir rapidement le paiement d’une créance incontestable ou peu susceptible d’être remises en question.
Elle est idéale dans les situations où un paiement immédiat est nécessaire, sans avoir à recourir à une procédure plus longue comme l’assignation au fond.
Si le juge accepte la demande, une ordonnance de paiement provisoire est rendue, exécutoire de plein droit.
2.1 Conditions pour engager un référé-provision
La procédure de référé-provision repose sur une condition stricte : La créance doit être certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable.
En d’autres termes, le créancier doit être en mesure de prouver que le montant de la créance est défini, que son exigibilité est dépassée, et que le débiteur ne peut opposer d’objection valable.
📝 Bon à savoir :
Cette procédure est recommandée si le créancier a la quasi-certitude que le débiteur ne contestera pas la créance ou que toute contestation serait infondée.
2.2 Les étapes de la procédure de référé-provision
- Dépôt de la requête :
- Le créancier doit saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature des parties impliquées (particulier ou professionnel).
- La requête doit inclure des preuves solides de la créance (contrat, factures, relances, etc.).
- Décision du juge :
- Si le juge estime que la créance est fondée, il rend une ordonnance exécutoire à titre provisoire, permettant le paiement immédiat.
- Si le juge rejette la demande, le créancier peut alors engager une assignation au fond pour poursuivre sa démarche.
- Exécution de la décision :
- Une fois l’ordonnance rendue, le créancier peut demander au commissaire de justice de signifier la décision au débiteur et d’exiger le paiement immédiat.
- En cas de non-paiement, le commissaire de justice peut mettre en œuvre des mesures coercitives comme la saisie des biens.
2.3 Avantages et limites du référé-provision
- Avantages :
- Rapidité : Une décision peut être obtenue en 30 jours dans les cas simples.
- Efficacité : L’ordonnance est exécutoire immédiatement, même si le débiteur décide de contester ultérieurement.
- Coût réduit par rapport à d’autres procédures comme l’assignation au fond.
- Limites :
- Si la créance est contestée de manière crédible, le juge peut refuser la demande.
- En cas de rejet, une procédure plus longue (comme l’assignation au fond) devient nécessaire.
3. L’assignation au fond dite assignation en paiement
L’assignation au fond, ou assignation en paiement, est une procédure judiciaire classique qui permet au créancier de résoudre des litiges complexes ou de récupérer des créances contestées, quel que soit leur montant.
Contrairement aux procédures simplifiées comme l’injonction de payer ou le référé-provision, elle implique un procès contradictoire où le juge examine les arguments des deux parties avant de rendre une décision.
Cette procédure est particulièrement adaptée lorsque le débiteur est susceptible de contester la créance ou lorsque des aspects juridiques nécessitent une analyse approfondie.
Elle peut également être utilisée après l’échec d’une procédure simplifiée ou lorsqu’une créance importante ou un litige commercial complexe est en jeu.
C’est une procédure qui est plus longue et plus coûteuse que les procédures simplifiées tels que l’injonction de payer et le référé-provision.
3.1 Étapes de la procédure d’assignation au fond
L’avocat du créancier rédige une assignation pour convoquer le débiteur devant le tribunal compétent (tribunal judiciaire ou de commerce).
L’assignation est notifiée au débiteur par un commissaire de justice.
Les deux parties exposent leurs arguments devant le juge.
Le juge rend une décision au terme du procès.
Si le créancier obtient gain de cause, le débiteur est condamné à régler la somme due.
En cas de non-paiement volontaire, des mesures coercitives, telles que la saisie des biens ou des comptes bancaires, peuvent être mises en œuvre à l’encontre du débiteur.
Une question ?
Nous accompagnons nos clients freelances, entrepreneurs & chefs d’entreprise dans le cadre de leur recouvrement de créances, et ce quelle que soit la taille de leur entreprise : indépendants, TPE, PME, ETI ou GE.
Contacter Maître FACCHINI Avocat expert en recouvrement judiciaire
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ?
N’hésitez pas à contacter Maître FACCHINI directement sur son téléphone portable, par email ou via le formulaire ci-dessous, un retour vous sera apporté dans l’heure !